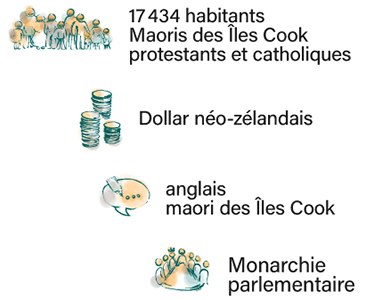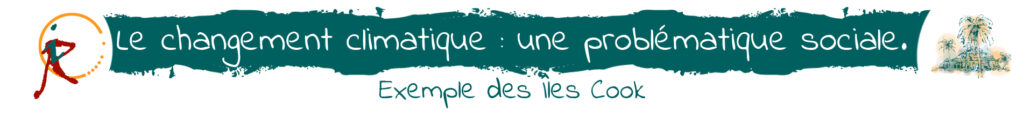
Auteur : David Glory
CREDO (AMU-CNRS-EHESS; UMR 7308) – http://www.pacific-credo.fr
Les Îles Cook, État insulaire du Pacifique sud, sont considérées comme particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. Elles sont au centre d’une importante mobilisation internationale pour les préparer à leur futur environnement.
Depuis trente ans, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat), évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses impacts. Les scénarios qu’il émet prédisent un risque majeur pour la survie des populations des États insulaires par les effets cumulés de l’élévation du niveau des mers, l’intensification des cyclones, le réchauffement des eaux océaniques et l’acidification des océans. Toutefois, le changement climatique ne doit pas seulement être considéré comme une question environnementale, c’est aussi une problématique sociale construite autour de cette interrogation : Comment les Maoris des Îles Cook comprennent le discours sur le changement climatique à travers leurs propres conceptions ?
Des idées venues de « l’étranger »
Depuis dix ans, de nombreux acteurs étrangers (ONG, organismes d’aide internationaux) interviennent dans ce territoire pour préparer les populations aux risques liés au changement climatique. Durant ces interventions, de nouvelles notions sont introduites telles que climat, temps météorologique, saison, environnement, nature, changement climatique selon une vision « universelle », autrement dit commune à tous, de penser l’environnement. Pourtant, ces notions ne correspondent pas nécessairement aux savoirs locaux et à la façon dont les Maoris des Îles Cook envisagent localement les modifications environnementales qu’ils observent.
Prendre en compte et préserver le savoir local
Les savoirs scientifiques sur le changement climatique se confrontent aux représentations et aux pratiques locales qui se retrouvent délaissées, voire abandonnées. Le « changement climatique » est devenu un mot « valise » qui sert à expliquer toutes les transformations environnementales. Des connaissances sur les cycles des plantes, des migrations animales, des courants marins ou des orientations des vents sont alors délaissées, malgré leur pertinence. L’enjeu des actions de sensibilisations consiste donc à trouver le point d’équilibre entre ces deux formes de savoirs en valorisant et préservant les compétences locales, fruits de plusieurs générations d’observation, tout en permettant aux insulaires de comprendre les enjeux contemporains liés au changement climatique.